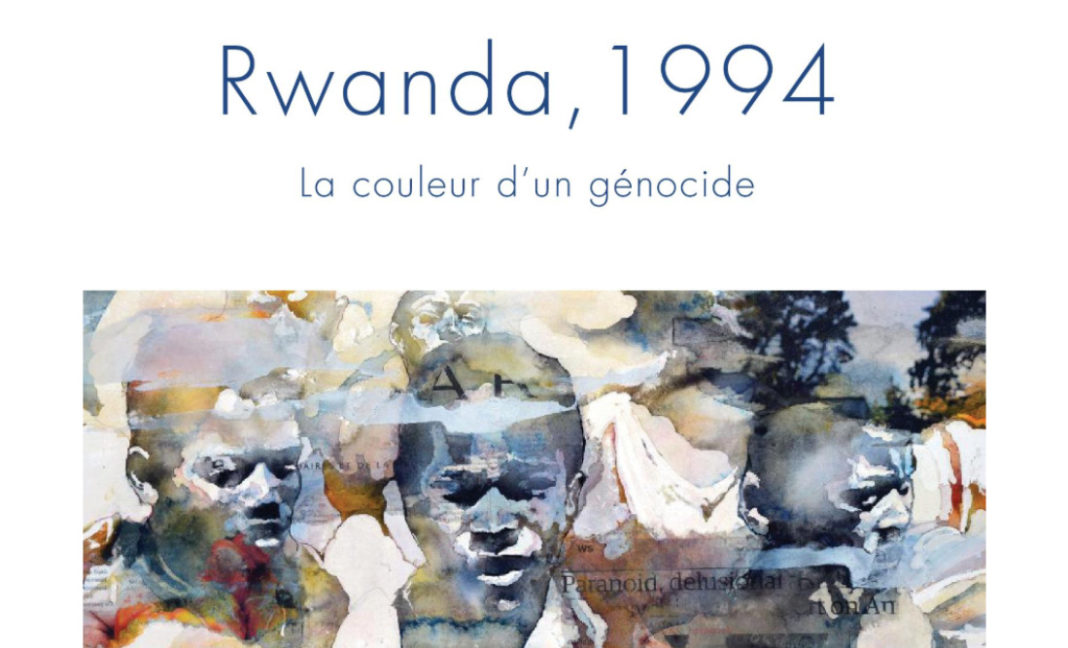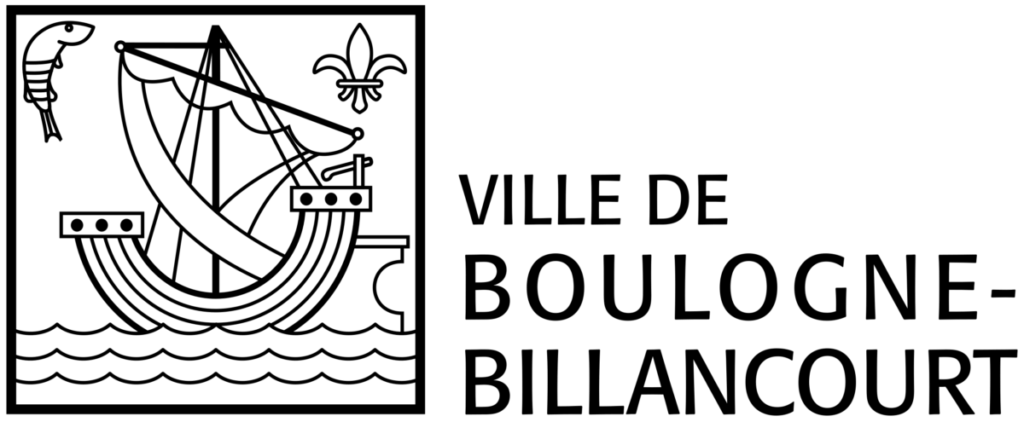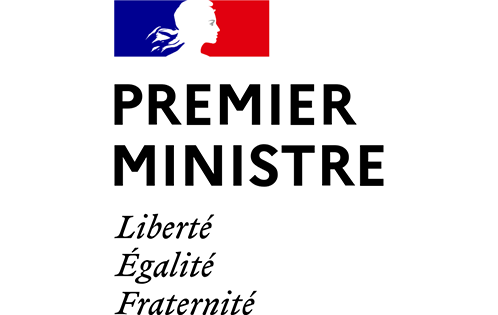Cette préface (qui pour des raisons de format est livrée en 4 parties : mais quand vous disposerez de l’ensemble je vous recommande de reprendre votre lecture d’un coup) est ma réaction au livre-témoignage de Diogène Bideri, philosophe et juriste rwandais, rescapé en 1994 du génocide des Tutsi.
Je tente d’y faire apercevoir ce qui est l’évidence qui s’est imposée à ma lecture : à quel point nous sommes tous touchés, par-delà la tentation de l’exotisme, par le génocide – non seulement par l’infinie compassion qu’on ne peut manquer d’éprouver, mais parce que la mort telle qu’elle se produit dans le génocide vient hanter notre présent d’individus mondialisés, et bouleverse ce que nous pensions notre identité de modernes. A quel point, pour le dire d’un mot, nous sommes nous également des rescapés de ce génocide lointain.
Diogène Bideri se présente lui-même comme un « rescapé du génocide » : « Diogène Bideri », « rescapé (auteur du livre) » écrit-il, ingénument.
Ingénument. Mais « ingénument » est-ce tout à fait le mot ? Ce qui immédiatement interpelle ici est plus complexe. Car se présentant au seuil de son livre dans le radical dénuement de qui s’avance, sans arrière-pensées, se présentant absolument – ecce homo – avec cette sorte de sincérité désespérée et presque inhumaine qui a renoncé à l’ordinaire conscience de soi tissée de ces non-dits qui précisément définissent ce qu’est la conscience, Diogène Bideri inscrit ain-si, d’emblée, son nom aux côtés de celui des morts – les membres de sa famille – « Ma famille en 1994 ». Son père, sa mère, quatre soeurs, trois frères qui ont péri lors du génocide ou des suites du génocide. Que peut vouloir dire dès lors « rescapé » ?
Est rescapé celui qui aurait pu mourir et qui, par un concours de circonstances en fin de compte inexplicable, a échappé au destin qui aurait dû être le sien et a survécu : et alors, c’est la pathétique et classique culpabilité du survivant qui ne cesse de questionner (avec une an-goisse perceptible aussi dans le récit de Bideri, et qui en est un élément) les raisons lui va-lant l’injustifiable privilège d’avoir survécu. Mais le rescapé ne se satisfait pas de se dire « je l’ai échappé belle ». Son sort est énigmatiquement, étroitement, lié à celui de ceux à qui il survit. Samuel Joseph Agnon, prix Nobel de littérature et immense écrivain du judaïsme, campe ainsi, dans une nouvelle, son narrateur errant sur les ruines d’un shtettl anéanti par une soldatesque nazie. Il y croise deux silhouettes avec qui il engage la conversation, jusqu’au moment où tombe cette évidence : « Je leur ai dit : permettez-moi de vous poser encore une question. Vous avez dit qu’après la deuxième catastrophe il n’est resté d’Israël personne dans la ville. Alors vous-même, vous n’êtes plus des vivants ! Ils m’ont souri alors, comme sourient les morts quand ils voient que nous pensons qu’ils ne sont plus vivants. »
Diogène Bideri, en tant que « rescapé » donc. Placé sous l’énigmatique lumière de la phrase de Agnon ce mot suggèrerait que la ligne ferme et indiscutable qui sépare la mort de la vie s’est es-tompée. « Je regardais, dit encore le narrateur d’Agnon, les habitants de ma ville, et il n’y avait pas trace de reproche dans leurs yeux de ce que j’étais comme ceci et de ce que eux ils étaient comme cela. » Comme ceci ou encore comme cela : voilà maintenant toute la différence.
Nous arrivons ainsi à la question la plus difficile. Qu’en est-il de la mort, dans le contexte d’un génocide? Y meurt-on, au sens ordinaire du terme ? Et déjà qu’en est-il de ce sens « ordinaire » ? Certes – et c’est le lieu commun de tout ce qui s’est jamais écrit sur la mort – la mort est toujours pour une vie, même pour la plus paisible et la plus quotidienne (et quoi qu’il en soit des innom-brables rites et cérémonials) solitaire, anonyme, inexorable, survenant à l’insu de celui qui meurt, en-dehors de lui, de sa conscience et de son aveu, de sa volonté : le mourant étant, comme le disait, en une terrible lapalissade, le sage épicurien, « là » quand la mort « n’est pas là » mais n’étant, quand la mort « est là », « pas là ». Néanmoins l’humanité vit avec cela, vit même de cela et comme cela, être homme c’est en fin de compte assumer cette déréliction, enrichir d’elle la vie, l’enrichir de l’insoutenable légèreté de cette vacuité qui paradoxalement pèse sur chacune de ses occurrences. L’effroyable hypothèse sur laquelle se bâtit au contraire le génocide nie cette affirmation obstinée des hommes qui est le fond de leur humanité, et par cela-même nie en chaque individu l’humanité.
Retrouvez l’épisode 2 dans la prochaine Newsletter « Antiracistes » de la LICRA le 27 juin 2019