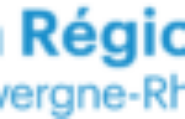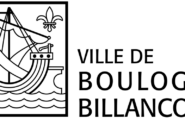Dans son éditorial publié le 9 mai 1945 dans Combat, Albert Camus rapporte le sentiment qui l’anime en ce jour de paix : « C’est ainsi que les années de l’asservissement ont été les années du silence. Et c’est ainsi que le jour de la liberté est un cri sans cesse répété par les millions de voix »
Pourtant, aux clameurs de l’armistice, aux volées des cloches et au branle-bas de la liberté allait succéder un autre silence, celui des rescapés de la Shoah. A Theresienstadt, au bout de sa tragédie, le jeune Robert Wajcman s’affale contre un mur. A l’annonce de la fin de la guerre, ses 16 kilos (oui, 16 kilos) s’effondrent en larmes, lui qui jusque-là n’en avait versé aucune, pas même à Auschwitz. En ce 8 mai 1945, il vient d’avoir 15 ans et déjà ses sanglots sont étouffés par la nécessité de survivre au coma dans lequel il est plongé des semaines durant, avant d’espérer vivre. La parole des rescapés est alors inaudible et les fantômes qui hantent les couloirs de l’Hôtel Lutetia risquent de jouer les trouble-fêtes. Le mot d’ordre est à la reconstruction et certainement pas à l’évocation de l’immense destruction qui vient d’avoir lieu, au cœur de la civilisation européenne.
L’histoire de l’extermination n’est convoquée par personne, de crainte de mettre chacun devant les devoirs qu’il n’aurait pas remplis au cours d’une époque qui, pourtant, les exigeait tous. Leurs colis réglementaires pour seuls bagages, les survivants essaient de porter seuls le poids de l’épreuve notamment quand ils recroisent le regard de ceux qui les ont dénoncés, quand ils trouvent close la porte de leur ancien appartement ou quand ils reconnaissent, en fonction, les policiers français qui les avaient entassés au Vel d’Hiv ou à Montluc. Certains pensent même au suicide, comme Esther Senot, qui a vaincu Auschwitz et les marches de la mort, et qui perd tout espoir devant l’absence des siens et la vie d’errance qui l’attend.
Et quand cette mémoire affleure prudemment dans l’opinion, elle n’est quasiment pas entendue, ou pire, elle est contestée. Le 17 mai 1953, à l’occasion de la pose de la première pierre du Tombeau du martyr juif inconnu, Charles Lévine, cadre de la LICA, relate son écœurement devant les graffitis antisémites qu’il aperçoit dans le métro en se rendant à la cérémonie. Il est abasourdi par la remarque d’un policier qui assure l’ordre de l’événement et qui glisse un « nous n’en finirons pas avec ces youpins ». La suite est connue. Il faudra attendre les années 1970 pour que la parole, doucement, se libère sous les coups de boutoirs du négationnisme qui s’étale, disserte et salit tout. Sous l’effet décisif des oeuvres irremplaçables de Claude Lanzmann et de Marcel Ophüls, de l’irrépressible besoin de justice réveillé par Serge et Beate Klarsfeld qui conduira Klaus Barbie, puis Paul Touvier et Maurice Papon, devant des jurés populaires. Sous l’effet, enfin, des paroles libératrices de Jacques Chirac prononcées le 16 juillet 1995.
Aujourd’hui, la liste des derniers témoins s’étiole et bientôt plus aucune voix de rescapé ne viendra frapper nos cœurs. Le cortège des falsificateurs, lui, grandit et leur mensonge n’a sans doute jamais eu autant d’audience à un moment où les discours de haine prolifèrent sur Internet. Si nous n’y prenons garde, le risque est grand d’entrer dans une période où la fin du temps des survivants ouvrirait la voie au relativisme, ce poison qui vise à faire de la Shoah une vérité contestable parmi d’autres. Alors, au moment où les yeux des témoins se referment, il est temps d’ouvrir les nôtres, de dire au monde que tant qu’il y aura des négationnistes, le génocide n’est pas terminé, de proclamer que le 8 Mai est pour notre génération le premier jour du reste de notre vie et devenir, avec responsabilité, les témoins des témoins. C’est le sens du projet que « Les Derniers », a produit depuis plusieurs semaines en partenariat avec la LICRA et la DILCRAH, et qui a permis, chaque soir, jusqu’à aujourd’hui, à des personnalités de la culture, venues d’horizons différents, de mettre leur voix dans la voix des rescapés. C’est un travail colossal qu’il nous faut accomplir pour transmettre, pour mobiliser cette mémoire au service des combats d’ici et de maintenant, pour enrayer des mécanismes dont on sait qu’ils écrasent tout et dont les signaux faibles sont toujours perceptibles. C’est un travail de Sisyphe qui nous attend. Mais pour revenir à Camus, « il faut imaginer Sisyphe heureux ».