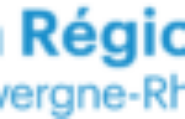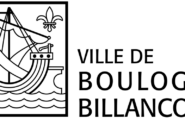Pour la première fois de son existence, l’Europe vacille sur ses bases. En son sein, certains veulent la quitter, d’autres espèrent l’abattre, d’autres encore l’affaiblir pour mieux s’en rendre indépendants. La question de fond est donc éthique : l’enjeu principal des élections de mai 2019, c’est le rapport à autrui.
Pays de soubresauts, de frondes, de jacqueries, de révoltes ou de révolutions, la France n’a cessé, dans son histoire, d’avancer par à-coups. Au point que le général de Gaulle pensait que le mot « réforme » y était révolutionnaire. Depuis le traité de Rome en 1958 et la mise en œuvre de la construction européenne, notre pays a pourtant profité de cette nouvelle contrainte, qu’il a peu à peu intériorisée. S’il n’a pas changé de nature, ni aboli son aptitude aux secousses les plus imprévisibles (les Gilets jaunes en sont la dernière manifestation), il bénéficie avec l’Europe d’une sorte de modulateur de sa capacité de changement. Entre le Marché commun et l’Union européenne, en une cinquantaine d’années, celle-ci a joué comme un levier introduit sous l’Hexagone, avec plus ou moins d’intensité en fonction des sujets, plus ou moins de pression suivant les époques. À l’histoire chaotique évoquée ci-dessus, faite d’avancées brutales, de réactions, de retours en arrière, de crainte du changement, elle a substitué silencieusement un modèle de type réformiste.
L’influence européenne
En pénétrant peu à peu dans la France, l’Europe la stimule. Si elle ne remet pas en cause le génie national, elle peut moduler le rythme de ses réformes indispensables et en accélérer l’application. Dès lors, plus l’Europe est forte, plus elle invite la France à évoluer dans le bon sens. Le plus significatif sans doute, mais aussi peut-être le moins visible au jour le jour, l’appartenance à l’Union a instillé dans les têtes la comparaison avec les voisins. Qui aujourd’hui conteste la nécessité de se mesurer aux partenaires européens, qu’on se tourne vers le coût du travail, les prélèvements ou la charge bureaucratique ? La logique comparative au sein de l’Europe ne devient-elle pas de plus en plus prégnante, qu’il s’agisse des résultats scolaires, du découpage territorial ou des déficits budgétaires ? Cela d’autant que l’Europe elle-même entre de plus en plus en concurrence avec d’autres zones du monde, ce qui renforce la stimulation. Depuis plusieurs décennies, les réformes françaises dues à l’Europe sont ainsi légions, qu’il s’agisse du droit des affaires, des règles de concurrence, du refus du monopole dans les services publics, du système éducatif (le système 3-5-8), de la fiscalité (notamment celle des fondations ou du prélèvement à la source), du budget de l’État (règle du déficit inférieur à 3 % du PIB) ou du contrôle monétaire (transfert à la Banque centrale européenne du contrôle de l’offre). Pays le plus centralisé du continent, contrairement aux pays fédéraux, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, contrairement aussi à ceux dont l’histoire a établi la force des localités, comme l’Italie, à ceux qui ont toujours attribué une importance majeure aux communes, comme l’Angleterre, ou aux contrées, comme l’Espagne, la France s’efforce de se décongestionner, là encore sous l’impulsion européenne, pour libérer des forces intérieures, attirer des investissements locaux et développer ses territoires. Sans doute pas encore assez. Même si l’Europe n’est pas parfaite et trop éloignée des citoyens, sa force concourt à l’affermissement de la puissance française, en favorisant les réformes indispensables. Cela provoque la peur de ceux qui redoutent l’évolution vers plus d’ouverture et croient trouver dans le populisme un antidote au mouvement.
Le refus populiste de l’ouverture
Les fascismes italien et allemand de l’entre-deux guerre comme l’impérialisme japonais d’alors se voulaient conquérants. La montée des populismes d’aujourd’hui, polonais, hongrois, italien, allemand, autrichien ou français, vantent les replis sur soi, comme aux USA. Ils récusent la nature même de l’aventure européenne, fondée sur le rapprochement des peuples pour écarter les nationalismes meurtriers qui ont ensanglanté le continent tout au long de son histoire. Certes, soixante années de construction paisible n’ont pas effacé d’un trait un millénaire d’ambitions hégémoniques, mais ils ont donné vie à l’espoir d’une histoire nouvelle. Pour que la paix économique l’emporte sur la guerre politique, il fallait remplir une condition impérative : voir en l’autre un partenaire, non une menace, chercher des accommodements avec lui, non le rejeter ou le renvoyer, d’où qu’il vienne. Cela ne signifie en rien abdiquer sa propre identité, mais donner effet au principe fondateur de la démocratie et de la paix : accepter pour chacun de renoncer un peu, pour ensemble obtenir plus.
« Même si l’Europe n’est pas parfaite et trop éloignée
des citoyens, sa force concourt à l’affermissement
de la puissance française, en favorisant les réformes
indispensables. »
À l’encontre de cette logique d’ouverture, les populistes comme les extrémistes en tout genre rêvent de consanguinité, d’entre-soi, d’exclusions et d’exclusive. Ils ne peuvent pas un instant admettre la définition que le poète Edmond Jabès donnait de l’étranger : « Celui qui te fait croire que tu es chez toi. » Ils se croient chez eux une fois pour toutes. Ils refusent de tirer le principal enseignement de l’histoire, récente et plus reculée : le nationalisme, c’est la guerre. Victor Hugo a écrit : « La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées. » En confondant ouverture à l’autre et renonciation à soi, le nationalisme et le populisme transforment le second volet de la formulation, qui devient : « La paix est une autre guerre. » Ils jouent le jeu électoral, non pour bâtir un édifice fondé sur l’espoir, mais pour détruire celui que les forces progressistes s’efforcent de consolider depuis des décennies. Ne plus respecter les valeurs fondamentales de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs (Pologne), les restrictions à la liberté de la presse (Hongrie), la politique à l’égard des immigrés (Italie) démontrent aux incrédules que populistes et extrémistes ne se présenteront pas aux élections pour créer, mais pour démolir.
Tel est l’enjeu du scrutin de mai 2019. Non pas répartir des sièges dans un Parlement, mais puiser dans l’âme de l’édifice européen élaboré depuis soixante ans pour lui permettre de surmonter ses ennemis les plus intimes, ceux qui n’acceptent ni la paix avec autrui ni son accueil pour s’enrichir de sa différence.
Charte des droits fondamentaux
adoptée par l’Union européenne le 7 décembre 2000 (54 articles)
Chapitre 1 (Dignité)
Article 2
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamnée à la peine de mort, ni exécutée.

Traité sur l’Union européenne
Chapitre 5. Titre 1 – Dispositions communes.
Article 1 bis
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que du respect des droits de l’homme, y compris des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité entre les femmes et les hommes.
Extrait article 2
L’union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.